« On les a parqués ! » « On les a ghettoïsés ! »
Mmm…Vraiment ?

« On les a parqués ! » « On les a ghettoïsés ! » « Tel est le sort des Noirs et des Arabes ! »
Ces phrases, je les entends ici et là, lancées avec une assurance déconcertante, comme des vérités absolues. On les scande dans les médias, on les répète dans les débats, et elles finissent par s’insinuer dans les esprits, prenant racine comme des évidences. Pourtant, ces affirmations sont à la fois simplistes, réductrices et profondément éloignées de la réalité historique, sociologique et économique. Elles traduisent davantage des postures idéologiques que des faits solides et étayés.
En 2023, j’ai publié un livre dans lequel un chapitre entier était consacré à cette question des banlieues, de leur histoire et des dynamiques qui les traversent.
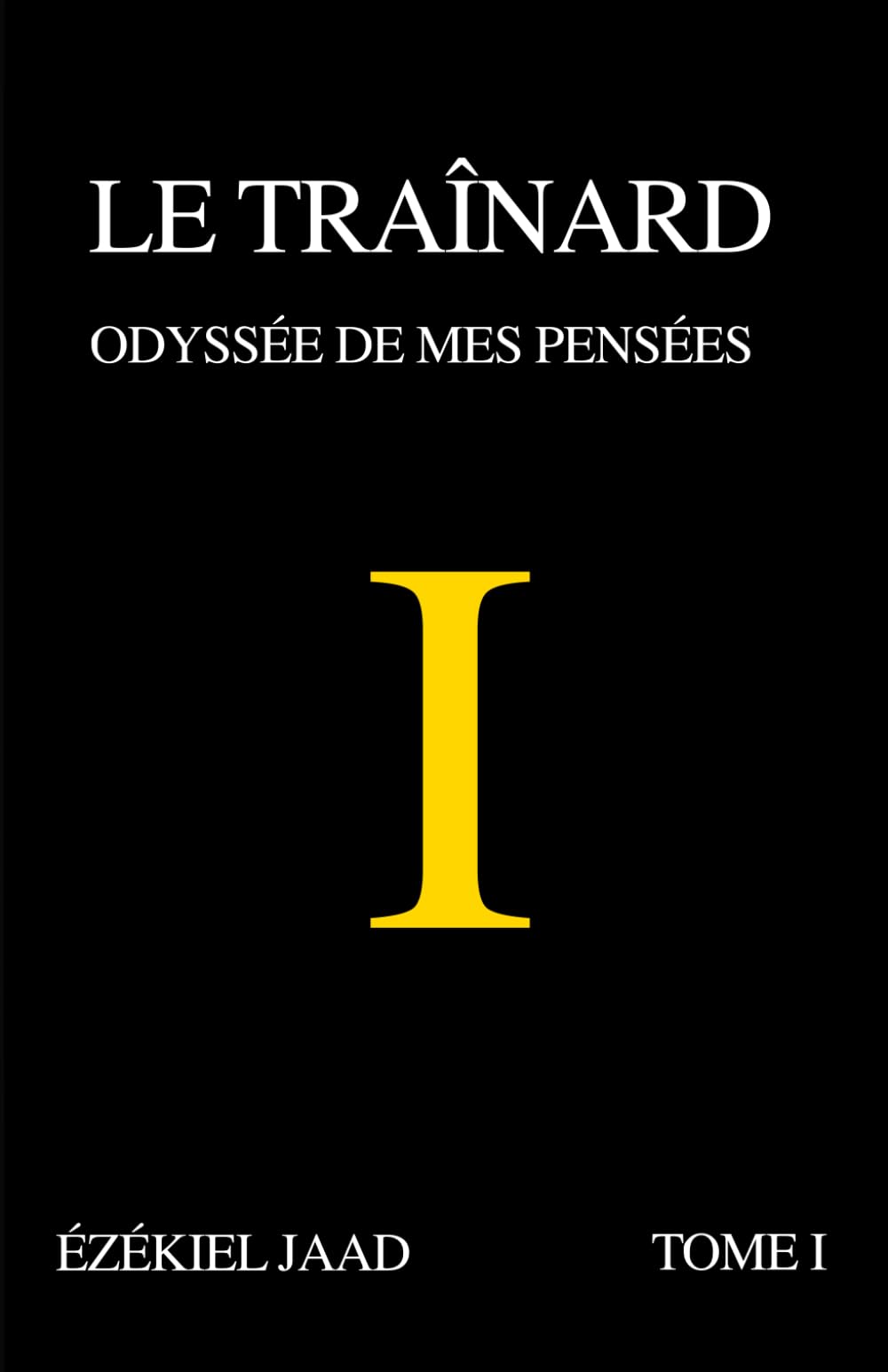
Ce chapitre visait à démonter ces récits trop faciles et à ramener le débat sur un terrain factuel. Car, à force d’entendre ces raccourcis simplistes sur les politiques de logement, on finit par oublier la complexité des choses, par écraser les nuances et par négliger l’enchevêtrement des causes et des conséquences.
Aujourd’hui, à travers ce support, je souhaite retranscrire et actualiser ce travail, car il me semble nécessaire de répondre à ces sorties trop souvent lancées sans réflexion ni fondement. Revenir à du sérieux, à des données concrètes, à une analyse holistique. Au-delà des slogans, des raccourcis ou des ressentis…
Extrait tiré de mon ouvrage, Le Traînard, Odyssée de mes Pensées, Tome I, Chapitre : Habitatio Socialis.
Habitatio Socialis
Me voici happé par les méandres du hasard, tombant sur une vidéo surgie du passé de 2016, où l’on aperçoit un étrange et étonnant spectacle : Jordan Bardella, revêtu de l’habit d’interviewer, accompagné d’un comparse, et en tant que client, si j’ose dire, l’islamologue et l’intellectuel Camel Bechikh.

Mon intérêt a été piqué par cette suggestion, connaissant un tantinet les idées de Camel, et trouvant en lui des points convergents, notamment sur la négation de la victimisation et la lucidité concernant la confusion, si fréquente, entre culture d’origine et foi, ainsi que d’autres points juridiques. Aux premières minutes de l’écoute, mes attentes étaient comblées, mais soudain, Camel Bechikh prononça une phrase qui m’interpella.
J’étais coutumier d’entendre pareil discours sortir de la bouche de Rokhaya Diallo, de Laurent Ruquier, d’Éric Fassin, de Tariq Ramadan, de Christine Angot ou d’autres encore, mais de lui, je ne m’y attendais pas. Pourtant, j’ai compris, à travers son anthropologie, son capital social, la raison de cette confusion.
Je vais m’expliquer là-dessus…
Point de grief à lui en faire, nul ne peut tout maîtriser, c’est là chose normale. Le moment qui m’a saisi fut lorsque l’interviewer, aux côtés de Jordan Bardella, posa à Camel une question sur les problèmes des descendants de la diaspora extra-européenne dans les quartiers, les problèmes culturels et d’assimilation. Camel Bechikh répondit d’abord en préambule qu’il s’érigeait contre la logique de SOS Racisme, qu’il avait toujours combattu cet éthos, mais, cela étant dit, il poursuivit en exprimant que, quelque part, il pouvait comprendre que lorsque des politiques de logement voulaient parquer les personnes au même endroit pour qu’elles ne fussent point en contact avec la France dite profonde, il y avait un problème.
Je compris ce qu’il voulait signifier, et c’était en partie vrai, mais seulement en partie, car cette vérité concernait le produit fini, et non pas la genèse…
Acte I : Ils les ont parqués..
De quel quartier s’agit-il dans cette vidéo ?
Ceux où les logements sociaux abondent, les banlieues.
Or, il faut saisir, historiquement, que les banlieues étaient peuplées, à l’origine, en grande partie d’autochtones français et d’autres immigrés européens blancs, tels les Italiens, les Portugais en général. Camel, ainsi que la pensée dominante depuis des années, soutiennent qu’il s’agissait là d’une politique de parcage volontaire, de ghettoïsation délibérée.
Pourtant, cela peut paraître étonnant aujourd’hui, mais il faut savoir que les gens se ruaient vers les logements sociaux à la base. Pour les Maghrébins d’origine, les Africains d’origine, lorsqu’ils venaient en France, ces logements sociaux étaient une bénédiction, non le fruit d’une politique coercitive visant à les damner. La France, en tant qu’État, n’est point dirigiste sur le plan du logement. Bien sûr, il y a la logique de la classe sociale qui fait que l’immigré paysan de Nador qui vient travailler à l’usine n’aura pas les moyens financiers d’habiter à Neuilly, sur ce point, nous sommes d’accord. Mais cela vaut également pour Michel d’Amiens, Français depuis 15 générations. Du point de vue des loyers accessibles, qui concernaient la plus grande majorité des Français et la plupart des immigrés qui arrivaient, il n’y avait aucun problème pour accéder à des loyers en dehors des quartiers ultra-bourgeois.
C’était précisément parce que ces habitats étaient considérés comme des habitats modernes, espacés, luxueux, qu’aussi bien les autochtones, les Portugais, les Italiens, les Maghrébins que les subsahariens s’y précipitaient. Il convient de se plonger dans le contexte de l’époque pour en saisir les nuances.
Aux prémices des HLM, avant leur essor, bon nombre de prolétaires, qu’ils fussent Français autochtones ou immigrés, vivaient soit dans des bidonvilles périurbains, soit dans une ruralité tout aussi précaire¹ .



Les bidonvilles s’étendaient principalement en périphérie des grandes villes françaises telles que Paris, Lyon et Marseille. Ils résultaient souvent d’une urbanisation accélérée et d’un cruel manque de logements abordables pour les populations défavorisées. Les bidonvilles de Nanterre, La Folie à Noisy-le-Grand et ceux proches de Marseille en témoignent.



Imaginez donc le contraste lorsqu’ils découvrirent pour la première fois les logements sociaux. Ces habitations, érigées en cette époque, se composaient généralement de grands ensembles, empreints d’une architecture moderniste, faits d’immeubles s’élançant sur plusieurs étages. Ces structures offraient, en outre, des espaces verts, des équipements collectifs tels que les écoles, les centres de loisirs et autres, ainsi qu’un accès facilité aux transports en commun. Le décalage avec les bidonvilles et les zones rurales précaires était tel que ces logements étaient considérés comme un véritable havre de modernité et de confort.





Et ce manque criant d’acculturation, cette cohabitation mise à mal entre autochtone et immigré, que déplore à sa manière, et à juste titre, Camel, ne trouve point ses racines dans une politique délibérée. Plusieurs raisons en sont à l’origine.
D’abord, ce sont tout bonnement les autochtones qui, de leur propre chef, par leur propre désir, ont déserté ces quartiers, sans égard à une directive verticale et explicite. Ils ont préféré, comme cela était souvent le cas, gagner des zones plus pauvres, des contrées rurales, dépourvues de services publics et autres commodités. Ils ont, en quelque sorte, sacrifié les avantages pécuniaires prodigués par ces quartiers, pour d’autres raisons : celles de l’ordre culturel. Ils estimaient que le confort culturel primait sur le confort financier. Même si certains d’entre eux avaient déjà cohabité avec les immigrés extra-européens dans les bidonvilles quelques années auparavant, la loi du nombre, la loi de la démographie et l’amplification ont progressivement changé la donne. De nouvelles cultures exogènes, s’imposant en leur fief, les poussèrent donc à partir.
Et l’une des preuves que le confort culturel prévalait sur le confort financier à leurs yeux, ce qui est en soi compréhensible, c’est qu’il y a eu, comme l’affirme le sociologue Hugues Lagrange dans son ouvrage « Déni des cultures », une sorte de « pas vers la cité puis deux en arrière² » .
À savoir qu’à un moment donné, les autochtones qui avaient fui ces quartiers décidèrent, face à la misère accablante de la ruralité, de peut-être revenir dans les logements pour plus d’avantages. Mais finalement, certains firent marche arrière, car, parmi plusieurs raisons, la variable culturelle reprit le dessus. C’est un phénomène bien connu qu’on appelle aux États-Unis le “white flight”.
Ce n’est point une politique délibérée, où le terrain était neutre et les pauvres immigrés parqués. Non, cela résulte d’une logique d’interférences sociales, avec son lot d’antagonismes. Ainsi, logiquement, lorsque nombre de Français autochtones, mais aussi d’immigrés d’origine européenne, commencèrent à déserter ces quartiers, la logique communautariste s’implanta.
Ce n’est pas un reproche, mais un mécanisme cohérent, par logique de proximité et pragmatisme.
Certes, cela s’amplifia, explosa, mais on est loin, si vous voulez, du schéma de départ qui consisterait à dire qu’il y a eu une politique concertée visant à parquer les immigrés – parce qu’immigrés et uniquement pour cela – en ces lieux, en des terres éthérées.
Et parmi les raisons, une à prendre en compte, qu’on n’entend guère, c’est qu’encore une fois, la banlieue était considérée de base comme un luxe, un privilège en ces années-là, et comme il y avait tant de demandes, autant de la part des autochtones – avant la massification culturelle exogène – que des autres, un moment donné il fallait réguler tout ce bazar, et privilégier les familles, les familles nombreuses.
Or, comme le rappellent les démographes, les statisticiens, les familles nombreuses de cette époque étaient souvent le fruit de familles immigrées extra-européennes ! Voilà l’ironie de tout cela, c’est que ces familles nombreuses issues de l’immigration extra-européenne ont été favorisées, en fonction de ce prisme-là et non du prisme qui consisterait à dire qu’on les parque là.
Car primo, ils n’étaient point obligés d’y aller, et secundo, c’est eux- mêmes qui demandaient à y aller, car c’était bien plus avantageux. Et pour preuve, lorsque c’étaient des familles autochtones avec moult enfants, ce genre de ménage sociologique, voyez-vous, les fameux parents qui donnaient comme prénoms Kévin et Jordan à leurs rejetons, cette classe populaire Française de souche, ainsi que des familles portugaises et italiennes, eh bien, c’était pareil, on les aidait à accéder à ces logements, on les mettait en tête des demandes avec les autres familles immigrées extra-européennes. Sauf qu’encore une fois, ces dernières, dans leur majorité, avaient plus d’enfants que les quelques exemples de familles nombreuses franco-françaises.
Par exemple, nous avons le témoignage d’un intellectuel issu de la gauche historique et traditionnelle, Jean-Claude Michéa, qui nous livre le récit suivant au micro du journaliste Guillaume Erner :

« Une chose qui témoigne vraiment du changement d’époque. Quand en 72 j’ai eu l’agrég et qu’on nous a demandé les vœux pour devenir enseignant. « Où voulez- vous aller? ». Comme beaucoup de copains du parti, qu’est-ce que j’avais demandé en premier ? Uniquement la banlieue ! Mantes-la-Jolie, le 9.3 et autres.
Pensez qu’en 1972, l’image de la banlieue c’était encore “c’est là qu’on vit bien” parce que dans notre HLM, les salles de bain, les douches, n’existaient pas. Se laver c’était dans l’évier de la cuisine. Et on savait qu’en banlieue il y avait des douches.
Et Yves Lacoste l’a démontré que si…la population a changé, c’est qu’à un moment donné la banlieue est devenue tellement demandée, loin d’être un ghetto comme l’a pensé Paris VIII [qui] le laisse entendre de nos jours, c’était tellement demandé qu’à partir d’un moment il a fallu réguler la possibilité de s’installer en banlieue. Et on a pris comme critère les familles nombreuses. Du coup le taux de fécondité des familles d’origine maghrébine et Africaine étant plus élevé, les banlieues sont progressivement devenues maghrébines et subsahariennes.
Mais c’était pas du tout, Yves Lacoste le rappelle, dans le cadre d’une politique de ghetto, de relégation. C’était le contraire. Puisque c’était un privilège de vivre en banlieue avec des espaces plus grands, des équipements culturels qu’on avait pas dans les quartiers ouvriers de Paris, et bien le biais des familles nombreuses a fait que ça a changé de composition culturelle. Mais c’était pas du tout une zone de ghetto³ . »
Moi-même, en mon for intérieur, je me rappelle de ma prime enfance, lorsque mes parents modestes s’acquittaient de loyers exorbitants dans des logements privés. Ces derniers, en plus d’amputer notre budget mensuel, étaient vétustes, sordides, insalubres, animés d’une faune grouillante, que ce soient souris ou cafards. Et pourtant, en cette journée où ma mère nous convia à visiter ce qui allait devenir notre antre, un logis social, je crus rêver. L’espace y était abondant, la propreté irréprochable, le modernisme criant.
Adieu la crasse et les nuisibles qui infestaient notre quotidien. Et le blanc des murs, si purs, si impeccables, demeure gravé en ma mémoire. Un paradis immaculé s’étendait devant moi. Bien sûr, ce n’était point Versailles, mais le sentiment de béatitude qui m’envahit était indescriptible. Et le loyer correct qui soulagea tant ma famille demeure le souvenir le plus précieux de cette époque pas si lointaine. Bien sûr, il y avait les aléas inévitables, les frondaisons d’humidité qui s’infiltraient parfois, les vacarmes herculéens provenant aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur, étant donné que c’était un « quartier » avec son lot de « racailles ». Quelques problèmes de tuyauterie émergeaient de temps à autre, ou autres péripéties domestiques.
Mais putain, mais bordel, rien n’était comparable avec l’abîme où nous résidions auparavant. Ce logis représentait pour nous un changement salvateur.
Je conçois tout à fait qu’il faille nuancer les banlieues, car toutes n’ont pas subi le même processus historique. Chaque lieu, chaque zone avec des logements sociaux, a connu une évolution différente dans le temps. Dans mon cas personnel, il est indéniable qu’au moment où nous découvrions les logements sociaux, dans notre contexte des années 2000, ce processus d’émerveillement était déjà à quelques années en arrière dans d’autres endroits. Je le reconnais.
Toutefois, je parle ici d’un processus global, d’une ossature commune qui est propre à un mécanisme similaire touchant la plupart des zones où se combinent la variable du logement social et celle de l’immigration. La variété ne se pose que sur la date, rarement sur le produit fini. Et en évoquant ce fameux « produit fini », je me range partiellement aux côtés de Camel, lorsqu’il affirme que l’acculturation doit se faire en raison du contact entre une minorité immigrée et une majorité autochtone, créant ainsi une forme de mixité sociale. Toutefois, nous ne sommes plus dans une logique ultra minoritaire en ce qui concerne les immigrés, notamment extra-européenne. Il faut également prendre en compte le fait que tout est question de vision par plaques. Jérôme, qui réside à Évry, par exemple, se pliera à des usages différents que s’il vivait dans le Cantal. Parfois par logique de survie ou pour d’autres raisons…
Je comprends donc ce que Camel veut dire lorsqu’il évoque le produit fini, mais c’est lorsqu’il en parle d’un point de vue conceptuel et génésique, que, à mon sens, il se trompe.
Acte II : Bruxelles..
Pour rebondir sur la seconde partie de cette vidéo, où Camel sous-entend que le fait d’être ainsi relégué peut contribuer en quelque sorte à la délinquance, j’ai déjà évoqué cette question dans un texte⁴ , je ne m’attarderai donc pas trop.
Mais prenons un exemple concret. Nous pourrions prendre l’exemple de Bruxelles – où j’ai habité plusieurs années – précisément, et qui ne possède pas véritablement de banlieue périphérique.
Les Marocains, les Turcs, les subsahariens, les immigrants les plus représentatifs de Belgique, résident dans la métropole bruxelloise depuis les années 60 et 70, vivant d’abord aux côtés des Belges autochtones. Il n’y a donc pas de schéma de banlieue périphérique, mais plutôt une hybridation urbaine, les quartiers dits populaires ou plus aisés coexistant à l’intérieur de la ville. Pourtant, cela n’a pas empêché les mêmes processus qu’en France de se manifester.
Au fil du temps, les Belges autochtones ont déserté ces quartiers, malgré leur avantage financier et leur facilité de déplacement, préférant partir soit en Wallonie, dans des zones rurales où le taux de précarité est grandement élevé, soit dans des zones un peu plus correctes, selon leur trajectoire. Et donc, avec le sens de la massification et de communautarisation, à l’instar de la France, nous en sommes arrivés à une situation où des zones telles que Schaerbeek, Molenbeek, une grande partie d’Anderlecht, Saint-Josse et Jette sont majoritairement peuplées d’immigrés.
Il y a même des endroits à Bruxelles où l’on peut rouler en voiture pendant de longues minutes sans apercevoir un seul Belge autochtone, et je pèse mes mots. Pourtant, nous ne sommes pas dans une logique de banlieue périphérique. Cela prouve que la question est beaucoup plus profonde que la vision binaire de banlieue ou de non-banlieue, de relégation ou de non-relégation. De plus, et pour revenir au vif, cela n’a pas empêché la délinquance maghrébine et subsaharienne de se développer dans les rues de Bruxelles, même si elle n’était pas recroquevillée dans des banlieues à la périphérie.
Au contraire, ces délinquants étaient à l’intérieur des villes. Il faut aussi comprendre que la plupart des racailles maghrébines et subsahariennes qui sévissent à Bruxelles, de 2000 à nos jours, sont issus de parents de la classe moyenne et pour certains même, d’une certaine forme de bourgeoisie. Les gens seraient étonnés de constater à quel point de nombreux parents d’origine maghrébine sont propriétaires de belles maisons, ce qu’on appelait autrefois des maisons de maître. Sans parler de celles construites au Bled.
Par mon expérience personnelle, j’ai pu constater que parmi mes compagnons d’enfance, ceux issus de la classe moyenne, voire supérieure, enfants de propriétaires ou de souverains de biens, tant à Bruxelles que dans les environs, étaient étrangement les plus racailles du groupe. Certains volaient, d’autres agressaient, tandis que quelques-uns étaient envoyés en prison. Pourtant, une poignée de mes amis, issus de conditions très modestes comme moi, pouvaient parfois envier leur situation financière, sans comprendre leur comportement.
Alors, si vous voulez, il est facile de dire que « Nous avons parqué les immigrés dans les banlieues, nous les avons ghettoïsés, et la délinquance a émergé ! », mais c’est un raccourci facile et plaisant. La réalité est bien plus complexe.
Cela ne fut point l’énoncé complet de Camel, bien que le sous-entendu en filigrane ne saurait être ignoré. Néanmoins, c’est d’une manière globale que je souhaitais rétorquer à ceux-là mêmes qui, en toute sincérité et sans la moindre réserve, s’enorgueillissent de telles idées.
Acte III : Oseille..
Cette vision sacrée, elle repose sur une présomption. Celle-là même qui suppose que la banlieue, c’est un endroit étouffant, laissé pour compte par les hautes sphères de l’État, et que d’y demeurer serait peu enviable. Car quand on parle de ghettoïsation, il est sous-entendu que c’est abandonné, ostracisé, mis de côté.
Ainsi, cette grammaire-là nous ramène directement à la grammaire économique. Puisque c’est ghettoïsé, c’est marginalisé, et comme c’est marginalisé, c’est abandonné financièrement. Mais ce raisonnement, objectivement, concrètement et historiquement, est faux.
Tout d’abord, il est prouvé sans difficulté qu’il y a eu pléthore de plans pour les banlieues, des milliards d’euros qui ont été injectés, et parfois même au détriment de certaines régions rurales où les autochtones vivent en masse⁵ . L’oseille a été distillée, cela était indubitable, mais quant à sa gestion interne, c’était une tout autre histoire qui impliquait les élus de ces contrées et les intervenants sociaux.
Deuxièmement, il est capital et substantiel de comprendre qu’à partir du moment où tu n’es pas trop éloigné des métropoles, tu as plus de probabilités d’ascension sociale en lien avec les besoins et les services demandés de ces mêmes métropoles, par une logique de mobilité, que Jérôme au fin fond de la Creuse, qui n’a pour seule issue qu’un court-circuit économique, avec tous les aléas qui vont avec. Sans oublier les infrastructures informelles, qui de par la sociologie des banlieues, la proximité, le réseautage, le capital social, permettent l’émergence d’économie parallèle.
En outre, ces banlieues sont régulièrement l’objet de l’attention de l’État et de ses politiques publiques – politiques de développement, politiques de la ville – et sont bien quadrillées d’infrastructures, notamment de transports publics.
Ainsi donc, nous reviendrions à cette variable mobile et économique dont bénéficient les banlieues en regard de leur géographie. La meilleure démonstration qui en soit est celle de la double réaction que manifesta le ministre Castaner à l’encontre des mouvements qui émanèrent, notamment les collectifs d’Assa Traoré et les Gilets jaunes. On peut voir à quel point la violence fut permise à l’égard des Gilets jaunes, et à quel point elle fut contrôlée à l’encontre des collectifs issus des banlieues. Comprenez bien le sous-texte qui se dessine ici, la logique économique et celle du rapport de force, hantée par la ‘ juridiction Malik Oussekine’, ont créé une distinction de traitement.
Cela étant dit, n’allez pas croire que mon dessein soit ici de fomenter quelque concurrence entre la ruralité théoriquement idéalisée, souffrant d’une précarité extrême, et cette banlieue submergée d’oseille et de dollars, telle une production hollywoodienne. Non, mon propos vise à rétablir davantage de nuances et de vérité dans tous ces discours doctrinaires, aussi bien d’un côté que de l’autre. Il ne s’agit pas de faire l’éloge béat d’une banlieue qui ne connaîtrait aucun problème, mais bien plutôt de conduire une analyse holistique jusqu’au-boutiste, dénuée de tout biais idéologique.
Acte IV : Des quartiers dégradés…
On perçoit couramment la complainte clamant que les services publics se fanent, se meurent dans les banlieues, où naguère un centre de loisirs fut embrasé, ravagé, brisé et autres calamités. Et aussitôt, la complainte suivante accuse l’État de ses négligences coupables. Or, comme nous l’avons constaté, l’État a déversé un flot d’or dans ces contrées suburbaines. L’erreur, à mon sens, réside dans la confusion entre le réceptacle et la substance, le réceptacle étant bien réel, pragmatique et efficace, tandis que la substance est soumise aux caprices des interférences.
Ce que je veux dire, c’est que le problème n’est pas l’architecture, ni l’abondance de deniers de l’État, mais ceux qui peuplent ces zones-là. Pour étayer mon propos, j’invoque ici deux témoignages, deux âmes différentes, ignorant sans doute l’existence l’un de l’autre, mais dont l’armature intellectuelle peut se rejoindre, se confondre… Le premier témoignage, intitulé « Blok 23 », est l’œuvre de l’écrivain Antonin Campana, tandis que le second est une transcription d’une intervention radiophonique d’un certain Maurice, qui exerçait les ondes libres dans les années 90 à Paris, répondant aux interrogations de deux auditeurs.
Bien que je maintiendrais quelques réserves et insufflerais quelques nuances à la fin des deux textes, ces échos, ces contributions demeurent importantes, peu communes aux oreilles boboïsées habituées aux mêmes rengaines, aux sempiternelles litanies.
« Antonin Campana, 2021.

« Le taxi nous avait laissés, ma femme et moi, au milieu de cubes de bétons, des tours et des barres percées d’étroites lucarnes qui laissaient filtrer des lumières jaunes ou blanches. La nuit était déjà tombée. Des groupes de jeunes étaient au pied des immeubles. On entendait leurs bruyants palabres, des ballons qui tapaient sur les murs, des aboiements de chiens, les cris des enfants et surtout, nous semblait-il, tant nous avions envie de passer inaperçus, le bruit que faisaient nos valises à roulettes sur les dalles disjointes des coursives. Intérieurement, je maudissais l’ami qui nous avait réservé un appartement dans un tel endroit. Nul besoin d’avoir fait un master en sociologie pour constater que nous étions sans aucun doute les seuls Français. Je vous passe la remise des clés de l’appartement, la vieille dame qui nous explique que nous étions au second et que nous avions de la chance, car il est préférable de ne pas prendre l’ascenseur, qui tombe souvent en panne.
Elle nous a bien avertis qu’il ne fallait surtout pas toucher aux portes intérieures de l’engin, car cela avait la vertu de le bloquer entre les étages !
De notre appartement nous avons fait la photo que voici :


Le lendemain, nous avons, ma femme et moi, entrepris de visiter la cité où nous allions habiter pendant six longs jours. Je ne vous cache pas notre désappointement. En journée, les bâtiments paraissaient encore plus délabrés que la nuit. Tout était gris, tout était terne, tout manquait d’entretien, tout respirait la pauvreté, si ce n’est la misère. La cité fourmillait de recoins et de passages obscurs qui devaient être de véritables coupe-gorges.
Le béton omniprésent se désagrégeait et laissait voir sa ferraille. L’herbe poussait dans l’encoignure des marches. Le parterre des lieux destinés aux enfants, aux jeux depuis longtemps disparus, était à l’abandon. Les passages étaient parsemés de trous et d’obstacles.
Tout sentait le bricolage et le rafistolage avec les moyens du bord.





Plusieurs milliers de personnes habitent dans cette cour des miracles et y vivent, nous l’apprendrons de notre ami, avec moins de 500€ par mois !
Pour un peu, en se laissant aller, on aurait, ma femme et moi, adhéré au récit pleurnichard que la gauche tient sur les banlieues. Comment en effet ne pas établir une relation entre cette pauvreté évidente et la délinquance ? Comment, dans de telles conditions, une cité, visiblement livrée à elle-même et abandonnée de tous, pourrait-elle ne pas devenir une zone de non-droit ? Ici, pas de services sociaux pour prendre en charge les jeunes, pas de maison de la culture, aucune « politique de la ville » pour continuellement entretenir, réparer, rénover les bâtiments. Aucun assistanat.
Rien à voir en effet, de quelque point de vue que l’on se place, entre cette cité et toutes les autres cités, qu’elles soient du 9-3 ou d’ailleurs !


Et pourtant ! Et pourtant, nous avons aussi visité la cité de nuit et nous n’y avons vu aucun point de deal, aucun check-point. Les groupes de jeunes dont nous parlions étaient des jeunes qui vous disaient « bonsoir » en vous croisant. Jamais nous n’avons perçu la moindre agressivité, ni même le plus petit soupçon d’impertinence. Des jeunes filles en jupes traversaient paisiblement les passages les plus sombres.
Elles se parlaient joyeusement. Dans le parc, des personnes âgées promenaient tranquillement leur chien à côté des enfants qui jouaient. Aucun bruit de moteur, aucun rodéo urbain, aucune voiture qui brûle, aucun dealer. Nous avons même vu, alors qu’il faisait déjà nuit, et cela à deux reprises, deux agents du « Parking Service », dont une femme, mettre des amendes à des voitures mal stationnées au pied d’une barre d’immeuble. Ils ont fait leur travail en toute quiétude, en pleine cité, gyrophares allumés, devant tout le monde, et sans l’appui d’une compagnie de CRS ! Le soir, nous allions dans les cafés de la cité et avons toujours été sympathiquement accueillis.
Il y avait des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes adultes.
L’ambiance était agréable. Généralement, vers 22h30-23h, le parc et les coursives se vidaient. Chacun rentrait chez soi et la cité restait silencieuse jusqu’au lendemain matin. En six jours, nous avons renouvelé nos visites de jour comme de nuit, en faisant toujours le même constat : la cité n’était pas « sensible », au contraire et paradoxalement, elle était très « paisible ».



Nous avons parlé plus haut de « cour des miracles ». Cette fausse impression se dégage rapidement pour peu que l’on s’immerge véritablement dans cet espace. Au contraire, vous éprouvez une sensation de paix et de sérénité et vous percevez même une certaine douceur de vivre, dont les habitants n’ont peut-être pas conscience. A aucun moment, vous n’êtes sur le qui-vive. Rapidement, vous sentez que vous ne craignez rien, que vous pourriez facilement vous installer dans la cité et vous y faire des amis. Les chiffres sont d’ailleurs sans appel : ici, il n’y a aucun viol, il n’y a aucune voiture brûlée et le taux de délinquance avoisine les 0%.
Pourtant, mis à part ma femme et moi-même durant ces six jours, qui ne furent pas si longs, je remercie mon ami de nous les avoir offerts, il faut admettre qu’il n’y a dans cette cité aucun Français ! En fait, il n’y a aucun Français… mais il y a 100% d’autochtones ! Les sociologues gauchistes devraient la visiter : ils apprendraient que la nature de la population compte plus que la nature de l’habitat. Car, vous l’aurez compris, cette cité n’est bien sûr pas en France. Elle est située en Serbie, à Belgrade exactement. Son nom est aussi dur qu’elle est attachante. Elle s’appelle le « Blok 23 » ! »
Maurice, Radio Skyrock, 1995.


– (Auditeur) : Qu’est-ce que tu penses des banlieues ?
– Je pense que dans ces banlieues, il y a beaucoup de gens qui ne servent à rien, qui sont des gens qui mettent le bordel, qui brûlent des caisses et qui abîment leur cadre de vie ! Et qui viennent ensuite pour me dire, et nous dire à nous tous, qu’on ne s’occupe pas d’eux ! Tu ne peux pas provoquer la bagarre et gueuler parce qu’il y en a, je ne crois pas ! Je ne suis jamais allé dégrader un immeuble à Sarcelles. Les mecs du VIIIe n’y vont pas non plus ! Les gens qui dégradent les banlieues sont d’abord les gens qui y habitent ! Les mecs font cramer des caisses, ce sont les caisses de leurs parents sur le parking du HLM. Ce qui leur déplaît après, c’est qu’il y a une carcasse sur le parking, une carcasse consumée que personne ne veut enlever, mais je dis « chacun sa merde » ! Dans les banlieues, il y a les lycées, le bordel dans les lycées ! Qui met le bordel ?
Les mecs du 8e, à moins que ce ne soient ceux du 11e arrondissement ou ceux du 4e arrondissement de Lyon ? Je crois que les mecs qui mettent le bordel dans les lycées de banlieue sont les gens qui vont dans ces lycées de banlieue. Ainsi, c’est la merde en banlieue, c’est parce que les gens qui y habitent mettent la merde ! Et tant qu’ils seront là, tant qu’ils auront cette mentalité, ça ne changera pas ! On pourra avancer du blé, allonger, refaire, retaper, ça ne changera pas ! Parce que les inscriptions sont omises par les gens qui y résident l’endroit !
– (Auditeur ) : D’accord, j’accepte ton point de vue, mais… –
– Ce n’est pas mon point de vue, c’est la vérité ! Ce ne sont pas les gens du 16e, du 8e, 12e et du 4e qui vont saccager les banlieues, ce sont les gens qui y habitent. Ce ne sont pas les gens qui sont ailleurs qui viennent menacer, et quand c’est les portes des gens, ce sont les gens qui habitent ! Je sais de quoi je parle, je vais y traîner le soir très tard, j’ai vu et je vois des choses et des gens qui font des conneries, et je me dis à chaque fois : « Putain, pour moi c’est le cinéma » ! Je vais, je regarde, et après ça, je rentre à la maison ! Ces gens-là mettent le bordel chez eux, qu’ils continuent à le faire, mais qu’on ne me demande pas de mettre la main à la poche, chacun sa merde !!
Tu casses chez toi, casse tout, c’est ton problème ! Qu’est-ce qu’il y a de moins à Sarcelles par rapport au 13e ? Rien. On fait plus de choses pour les jeunes ? Non, je ne crois pas. Qu’on ne fait pas plus de choses pour les jeunes dans le 8e arrondissement de Paris, on ne fait rien sur les Champs-Élysées pour les jeunes, et même pour les Français, on fait des choses pour les gens qui viennent regarder la vitrine ! La seule différence, c’est la mentalité. Il y a des gens qui savent s’installer dans un coin et bouquiner, et donc qui s’imaginent qu’exister, c’est sortir un couteau, un gun ou une seringue pour aller la mettre sous le nez de celui qui passe ! Ce sont les banlieues qui mettent la merde chez elles !
– (Auditeur) : Ouais mais ça, c’est la mauvaise image de la banlieue, parce que franchement, il y a des jeunes qui essaient d’arranger ça, de …
– Il y a des jeunes qui essaient d’arranger ça, Fabrice. Mais il y a aussi d’autres jeunes qui pérennisent le système, qui le poussent à continuer à exister ! Ce sont à ces gens-là qu’il faut aller parler. Je suis foncièrement contre les mesures diverses et variées. Je dis que c’est à ces gens de s’occuper de ce qui se passe chez eux ! Alors il y a ceux qui veulent faire payer ceux qui mettent le bordel. Il faut raisonner ceux qui mettent le bordel, pas venir nous emmerder !
– (Auditeur) : Ouais, mais en fait, ceux qui mettent le bordel, c’est peut-être parce qu’on les pousse un peu trop quand même !
– Qui les pousse, moi ?
– (Auditeur) : Ceux qui ne font rien pour les aider.
– Et pourquoi est-ce qu’on aiderait ces gens ? Tu m’as aidé, toi ? Les banlieues m’ont aidé un jour dans ma vie ? Jamais ! Pourquoi est-ce qu’on t’aiderait, toi ? Parce que tu as choisi d’habiter dans une habitation à loyer modéré, parce que tu paies moins cher ton loyer, donc forcément on doit te donner un coup de main ? On ne t’en donne déjà pas un ? Tu n’as pas un logis ? Tu n’as pas Canal + ? La télé couleur à la maison et un salon en cuir ? J’espère que tu rigoles.
Vas faire un tour ce soir et regarde les bagnoles qu’il y a sur le parking de chez toi. Tu vas tomber sur le cul ! Des voitures Balladur, il n’y en a pas, des 505, elles sont toutes à la poubelle ! Ce qui reste, ce sont des voitures fraîchement achetées avec des crédits ! Pourquoi est-ce qu’on aiderait plus les mecs de banlieue que les mecs d’ailleurs ? Est-ce qu’un mec qui habite Saint-Germain-en-Laye, on lui a filé un coup de main pour acheter sa maison ? Non. Pourquoi est-ce qu’on devrait filer un coup de main à un type qu’on aide déjà ? On lui donne un appart moins cher qu’ailleurs et ils y habitent. Il vient me dire maintenant qu’il est malheureux… qu’il quitte l’appartement qu’il le laisse à un autre !!
– (Auditeur) : Tu habites à Paris, non ?
– J’habite à Paris ! Oui.
– (Auditeur) : Tu connais vraiment la banlieue ? Tu connais réellement les problèmes de la banlieue ?
– Oui, les problèmes de la banlieue, je les connais. Il y en a plein dans les journaux. Il y a des gens comme toi qui sont malheureux toute l’année et qui viennent nous dire que c’est parce qu’on ne les aide pas ! Je dis qu’on n’a pas à les aider, ils n’ont qu’à se débrouiller tout seul ! Un mec pour travailler à l’école n’a pas besoin d’une aide, il a juste besoin de se dire qu’il faut travailler ! Parce que dans les lycées de banlieue, quand il y a une classe et un professeur, il y a les mêmes éléments que dans le 16e arrondissement de Paris : il y a un prof, des élèves, point !
Il y a, dans les lycées de banlieue dont nous parlons toi et moi, des gens qui se mettent debout, qui crachent, qui pètent, qui arrachent, qui lancent, qui menacent ! Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ? J’ai entendu ce matin qu’il y avait des profs du côté de Rouen qui ont décidé d’arrêter de bosser ! Ce sont ces mecs-là qu’il faut soutenir ! Les mecs qui en ont marre qu’on les menace, qu’on les traite de tout ! Ils viennent pour essayer d’enseigner quelque chose à des gens et le discours, c’est « Non, ne comprenons pas ces gens qui essaient de bosser, qui ont préparé des diplômes, essayons d’aider ces jeunes malheureux qui font chier tout le monde et qui se plaignent toute l’année ! » À cela, je dis merde, mon vieux, merde profond !
Deuxième intervenant…
– Quel âge as-tu ?
– (Auditeur) : 25 ans !
– Qu’est-ce qu’il y a ?
– (Auditeur) : Eh bien, je t’appelle par rapport à ce que tu as dit tout à l’heure sur les banlieues ! Bon, assez souvent, j’aime bien ce que tu dis, car je trouve qu’effectivement, tu as un regard différent, assez différent…
– Je n’ai absolument rien à foutre… Ce qui m’intéresse, c’est ce que tu as à dire là, maintenant.
– (Auditeur) : Et donc, ce que j’ai à dire là, maintenant, c’est que par rapport aux banlieues, je ne suis pas du tout d’accord, parce que je crois que
les problèmes ne viennent pas que des gens qui sont dans les banlieues…
– Ils viennent de qui ?
– (Auditeur) : Ils viennent avant tout de nous, ils viennent d’une société…
– Ah oui ? Ils viennent de nous et d’une société ! Quand un mec fout le bordel dans une classe, tu vas me raconter que c’est une société qui fout le bordel ? Tu vois ? Les problèmes des banlieues, c’est un ensemble d’actions ! Pourquoi est-ce que madame Michu a la trouille de sortir à je ne sais où à La Courneuve à 2 heures du matin ? Parce qu’elle a une amie qui s’est fait ouvrir le bide un jour ! Et ça, ce n’est pas la société, ça, c’est un mec qui habitait dans cette cité, qui traînait là le soir et qui en a profité !
Pourquoi est-ce que monsieur Je-ne-sais-quoi ne veut pas laisser son autoradio dans sa caisse ? Parce qu’un beau jour on lui a pété un carreau et on a pris son autoradio, ce n’est pas la société, c’est le mec qui habite là qui a choisi de le prendre ! Pourquoi est-ce qu’il y a des gens qui passent devant des groupes de banlieusards et qui baissent les yeux en disant « j’espère que ça ne va pas durer longtemps » ? Parce qu’un jour, il y a un type qui s’est arrêté, qui a dit « Quoi, qu’est-ce qu’il y a le môme? » et puis que les 50 lui sont tombés dessus !
Ce n’est pas la société ça, ce sont des gens qui font ça et ça s’arrête là ! On peut très bien généraliser à tout va, se dire qu’on ne pourra pas régler ça sauf à coups de dollars et de blé, moi je n’y crois pas, je crois que c’est d’abord dans la tête ! Si tu ne branles rien à l’école, ce n’est pas la société, c’est toi qui fais un choix ! Tu peux faire ce choix, mais ne viens pas me faire chier après ! Et lui a décidé de ne rien foutre, téléphone à ses profs qui sont dans la banlieue de Rouen, qui ont décidé d’arrêter de se faire traiter de tout par les élèves et explique-leur que c’est la société qui met le bordel dans leur classe, que c’est la société qui les effraie tous les jours !
À ces gens-là, je dis, et Dieu sait que je ne suis pas forcément pour le fonctionnaire, je dis « Putain, bravo les gars, arrêtez tout, coupez le contact jusqu’à ce qu’on foute dehors les mecs qui foutent le bordel, jusqu’à ce que vous puissiez faire le boulot pour lequel on vous paye » Ou alors, allez-y franchement, venez avec une batte de baseball puis démontez la tronche du premier gamin qui va bouger ! On verra ce qu’ils vont dire les parents, on verra s’ils vont considérer que tu as le droit ou pas.
Il y a un moment où cet équilibre que tout le monde voudrait avoir à chaque instant, un moment où il va falloir le fabriquer. Est-ce qu’on joue à la guerre dans les classes ou est-ce qu’on dit aux mecs de se calmer ? On dit tout et rien aujourd’hui, on dit que c’est la société ! Ce n’est pas la société, Stéphane, ce sont des gens ! Les graffitis que tu vois sur les murs des HLM, ce n’est pas la société qui vient les mettre, ce sont des gens, vraiment ! Même si on te les montre à la télé en te donnant l’impression que c’est international, ce n’est pas vrai, ce sont des gens, vraiment, qui vont et qui bombent les murs !
Il y a des gens qui habitent dans des immeubles lorsqu’il y a un graffiti, une marque, on leur dit maintenant on va diviser par le nombre de résidents et on va refaire le couloir, on va refaire l’entrée parce que c’est intolérable ! Et puis il y a des endroits où on dit aux mecs que c’est le HLM, habitation à loyer modéré, t’inquiète pas, tu peux taguer, tu vas aller râler après, puis un de ces jours tu auras les crédits, on va tout nettoyer et tu pourras recommencer !
-(Auditeur) : Mais les gens, Maurice, c’est la société ! La société, ce n’est que les gens et le problème, on ne peut pas le régler aussi facilement. Au moment qu’il faut, bien sûr, dans des cités, dans des banlieues où il y a cinq tours qui feront chacune 20 étages, ça, c’est 5000 personnes qui sont là. Avant, quand il y avait cinq personnes quelque part, c’était un village, avant il y avait un maire, il y avait une école, il y avait plein de choses qui étaient au même endroit et qui créaient des liens entre les gens. Alors, c’est vrai, bien sûr, les gens ont leur part de responsabilités, bien sûr que le dialogue petit à petit…
– Stéphane ?
– Oui ?
– Stéphane, arrête de dire n’importe quoi. Il y avait quoi avant qui réunissait les gens, s’il te plaît ? Il y avait des endroits, des lieux où les gens pouvaient se retrouver ! Aujourd’hui, il y a des jardins, il y en a plein les banlieues, des jardins et des bandes dedans. Ils ne peuvent pas se retrouver là, les gens ? Aujourd’hui, il y a des troquets dans les banlieues, les gens peuvent se retrouver dans les troquets, ils peuvent le faire ! Pourquoi ?
Parce qu’avant, les gens avaient beaucoup plus qu’aujourd’hui. Regarde l’histoire, mon vieux, il y a quinze ans, il y a vingt ans, il y avait moins dans les banlieues qu’aujourd’hui ! Il y avait moins de jardins, de réverbères, moins de cabines téléphoniques. Qu’est-ce qu’ils font, les mecs ? Ils s’asseyent dans l’entrée et disent que la société ne va pas ? Va faire un tour dans le 16e arrondissement de Paris, tu vas voir si les mecs sont assis dans l’entrée. Ils ne sont pas assis dans l’entrée, les mecs, ils sont soit dehors, soit dedans ! Si les parents ne veulent pas qu’ils aillent courir et traîner le soir, ils sont à la maison, ils écoutent mon émission ou une autre ! Ou ils bouquinent, ou ils travaillent ! Qu’est-ce qui empêche l’homme qui habite les banlieues de faire pareil? Explique-moi, c’est la société?
– (Auditeur) : Non, mais comment… Pourquoi, à ce moment-là, des endroits comme à Toulouse ou même ailleurs, les gens arrivent à rétablir les dialogues, arrivent à faire que, finalement, les gens ne soient plus vus comme ça en coin ou de travers… et que ça n’a plus les mêmes tensions!
– Mais ça n’a aucun rapport, putain, Stéphane, ton histoire de communication et la dégradation générale de l’immobilier des banlieues ! Parce que le premier problème est là! Quand on vient avec de l’argent, on fait quoi d’après toi ? On rétablit la communication ? On établit par la communication ! On prend un peintre, on lui dit « Repeins »! Je connais plein de banlieues qui ont été repeintes, ça fait un an à peine ! Va faire un tour, tu vas voir, tu as envie de vomir ! Tu te dis « Putain », c’est la société qui quoi ? L’immeuble, des vieux immeubles dans toutes les villes de France qu’on n’a jamais repeints qui sont là avec eux, leur pollution sur la façade, mais pas un graffiti !
À l’intérieur, t’as une vieille peinture marron qui date d’il y a 10 à 25 ans, qui n’a pas un graffiti ! Pas un « j’aime Géraldine » ou « je vais te prendre dans un sous-sol » qui fait ça si ce sont les gens ? Dis-moi ? C’est la société ? On peut se dire on ne va rien faire, on va tout régler avec de l’argent ! On peut se dire et on peut aller voir ses profs de Rouen qui ont arrêté de travailler, leur dire t’inquiète pas, on va mettre de l’argent ! Ce n’est pas de l’argent qu’il faut, c’est un système, quelque chose pour calmer ces mômes qui mettent le bordel ! On peut ne rien faire en se disant qu’un jour la société ira mieux, mais on peut aussi se dire finalement ce sont des gens qui mettent le bordel et le souk, c’est à ces gens qu’il faut parler ! Arrêtez de leur faire croire que ce sont d’autres qui vont régler les problèmes qu’ils créent eux-mêmes, qu’ils se créent à eux-mêmes !
– (Auditeur) : Oui, mais enfin, avant dans les villages tu avais tous les gens qui étaient au même endroit et où les différentes couches de tous les milieux socioculturels étaient au même endroit ! Aujourd’hui dans les tours, ce sont des personnes qui ont les mêmes origines, donc forcément…
– Qui t’a raconté ça ?
– (Auditeur) : Dans les banlieues, dans les HLM, ce n’est pas généralement les gens du 16e qui vont y habiter, Maurice. Donc forcément…
– Non, puisque les gens du 16e habitent dans le 16e si tu veux ! Mais si tu fais très attention à l’actualité, tu te rendras compte que très récemment on a parlé des HLM, notamment ceux qui se trouvent au centre de Paris ! Je crois que j’ai entendu qu’il y avait des journalistes, des gens très en vue qui habitaient les HLM, c’était là que résidait le scandale ! Dans les HLM il y a de tout mon vieux, absolument de tout ! Regarde les parkings des HLM, la bagnole chez nous, c’est une carte de visite ! Tu vas voir que dans les banlieues il y a de tout, vraiment de tout ! Et puis dans les banlieues, ben il y a les spécialistes de la dégradation et ces spécialistes, aujourd’hui on leur dit « pas grave, dégrade mon vieux, dégrade, c’est la société ! »
Dans d’autres quartiers, il y a d’autres gens et on leur dit « ne dégrade pas, autrement on va te choper, et tu vas être obligé de financer immédiatement » ! La différence elle est là, elle est simplement là ! Tu vois… l’école publique, celle qui est ouverte à tous, a une caractéristique principale qui est d’accepter tout et n’importe qui ! À l’inverse, il y a l’école privée ; il y a de tout dans les écoles privées, tu sais. La seule différence, c’est le climat ! Dans une école privée, très souvent, on dit aux gens : ici on ne met pas le bordel ici, on travaille. Dans les écoles de l’armée, il y a de tout, absolument de tout ; personne ne fait de graffiti sur le mur, personne ne se met debout dans la classe à l’école de l’armée. T’as pas un mec qui fume une clope à 2h30 du matin dehors ! Il n’y a pas un type qui va faire des marques avec un canif sur une jeep de l’armée qui mériterait un décrassage, parce que là-bas, on dit aux gens qu’il ne faut pas dégrader ! Tu fais le tour des grands hôtels aussi, tu verras que personne n’est dans le sous-sol de l’hôtel en train de marquer des trucs, parce qu’il y a marqué : « Ici, on ne met pas le bordel » !
Réfléchis un petit peu, c’est une question de climat et une question de volonté aussi ! L’ami qui habite cet immeuble richissime, celui qui te fait rêver, eh bien, quand il est là et qu’un type passe avec un feutre à la main, il le regarde dans les yeux pour bien lui faire voir qu’il l’a vu ! Si jamais il y a une marque sur le mur, on va le retrouver, le mec avec le feutre à la main ! Et on ne va pas le battre, non, pas comme dans les banlieues ; on ne va pas lui taper la tête par terre à plusieurs, en l’insultant et en lui parlant de sa mère ! On va le faire sortir le chéquier, on va le faire financer la dégradation ; la différence, elle est là, mon vieux ! Tu sais, la banlieue, c’est la banlieue ; celle dont nous causons, c’est un ensemble d’appartements.
Va chez ces gens qui dégradent, va voir s’il y a des graffitis sur les murs dans la salle à manger ; il n’y en a pas, je te promets. Je connais quelques types, moi, qui mettent le bordel chez eux ; c’est un peu le souk, mais tu ne peux pas pisser sur la TV, c’est pas possible ! Parce que chez eux, on ne pisse pas sur la télé, tu entends ? On peut faire de l’ordre chez soi, en se disant que personne ne viendra faire un chèque pour changer le fauteuil qu’on aurait crevé un jour, énervé avec une fourchette ! Et puis, on peut aussi se dire : c’est pas grave pour dehors, je vais continuer à pisser dans les couloirs ; quelqu’un, un jour, viendra dire que c’est la société et viendra nettoyer à ma place ! Comme ça, je pourrais continuer ! Pense à ça au lieu de pleurer toute l’année, dis aux gens que la société est composée de la population et que la population, ce sont des gens. »»
…
Alors…
Pour la première missive, où je me permets d’ajouter une nuance – sans prétendre connaître parfaitement les intentions de l’auteur – c’est lorsqu’il conclut, finalement, que des autochtones, donc des Serbes, peuplaient cette cité, laissant sous-entendre que leur présence, de par leur nature même, rendait les lieux plus paisibles. Je souscris, partiellement, car là où je m’oppose, c’est que ce n’est point l’essence serbe qui préserve d’une dégradation quelconque, de la relation à la ville, au bien public, à la cité elle-même, mais la représentation contextuelle qui en découle.
Une absence drastique des troubles identitaires, car l’on est en osmose avec l’endroit où l’on se trouve, est le sujet. Ensuite, logiquement, être autochtone en est l’incarnation. Mais prendre sa substance en fonction d’un paradigme anhistorique dénué de toute tonalité contextuelle, c’est une prise confuse. La preuve en est que les Marocains du Maroc partagent ce même lien avec leur environnement que les Serbes, selon mes observations personnelles.
Cependant, pourquoi, dans ces cités françaises où la population est majoritairement d’origine extra-européenne, notamment maghrébine et subsaharienne, ces problèmes surgissent-ils ? Comme je l’explique dans l’un de mes textes, il y a plusieurs variables à prendre en compte, comme par exemple le vivier décolonial créant ainsi une déshumanisation de l’espace, etc.
Je rejoins donc partiellement l’auteur sur cette question. En tant que produit fini, je suis d’accord, mais il s’agit d’une question de conception. Je ne prétends pas que l’auteur ait une vision réductrice, presque chromosomique ou fataliste, mais puisqu’il n’a pas nuancé son propos, je le fais à sa place. Libre à lui, bien sûr, de penser ce qu’il veut.
Quoi qu’il en soit, l’objectif central du texte était de montrer que la pauvreté n’est pas toujours le facteur déterminant qui pousse les gens à devenir des racailles. Et sur ce point, il a raison⁶ .
Quant au second écrit, celui de Maurice, il a d’abord su me voler quelques sourires, avec ce passage sur Géraldine, prénom d’un autre temps, réservé aux aïeules, l’autoradio qui me plongeait en enfance, et ces expressions désuètes que l’on n’entend plus. Hormis cette forme qui m’a quelque peu amusé, je souscris au fond du texte, car il faut saisir le contexte : nous sommes en 1995, et Bourdieu est alors presque prophète, omniprésent sur les ondes, même si j’étais trop jeune pour m’en souvenir. C’est en épluchant les archives, en étudiant méticuleusement les forces médiatiques de l’époque, que j’ai pu le constater.
Avoir, à cette période, une vision qui transcendait le déterminisme, le fatalisme, le lien sacré entre pauvreté et délinquance, sortant des jérémiades sur les conditionnements, était fort rare.
Aujourd’hui, la voix dominante reste la même dans les médias et les universités, mais les réseaux sociaux et les médias alternatifs offrent une certaine débrouillardise numérique. Il faut donc se replonger dans le contexte de 1995 pour saisir combien le discours de ce Maurice, dont je découvre l’existence à peine quelques mois plus tôt, était subversif pour l’époque. Car, hormis Gégé du bistrot qui l’affirmait à voix basse, craignant de se faire molester une fois sorti de son repaire, rares étaient ceux qui osaient tenir pareil propos.
Pour conclure..
Je me souviens, à titre personnel, j’avais alors 17 ou 18 ans, d’une escapade pour revoir une jeune fille que j’avais courtisée la veille, elle-même accompagnée de son amie et moi, d’un camarade. Nous nous étions rendus dans son quartier, qui rappelait les nôtres par l’architecture, cette odeur modeste qui s’en dégageait, mais qui se distinguait par la profusion d’équipements publics : une bibliothèque ouverte à tous, des haltères et des installations de fitness accessibles.
Le pote qui m’accompagnait incarnait à la perfection l’archétype de la racaille, possédant tous les ingrédients, tout le package, comme on dit. Pas de souci pour moi, mon entourage était des plus éclectiques et, avouons-le, cet enfoiré savait me faire rire. C’est alors qu’il avait prononcé cette phrase, porté par un sourire en coin et un regard malicieux :
« Putain de merde, assahbi, on est dans un autre monde ici, ça se voit qu’on est chez des gwers. Chez nous, tout ça aurait déjà été cassé et volé, taboundimehoum ! »
En assénant un coup de pied à un équipement public, au cœur de cette cité. Un quartier, que je le rappelle, peuplé de gens plutôt modestes, car au-delà de ce que l’on ressent, de ce qui ne se calcule pas mais se comprend d’emblée entre initiés,
il y avait aussi la fameuse « carte de visite » qui ne trompait jamais.…
1. « Les bidonvilles des années 1960: des marges urbaines aux marges de l’histoire » – Delpirou. « Le logement social en France » – Bonvalet, C., & Maison, D. « Les grands ensembles: une histoire qui continue » – Hirschhorn, M. dans Le Monde diplomatique. « La double absence : des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré » – Sayad, A. « Aux origines du logement social en France, 1850-1914 » – Fourcaut, A. « La politique du logement en France » – Merrien, F.-X., & Navez-Bouchanine, F.
2. « Déni des Cultures » – Hugues Lagrange, notamment le chapitre « Isolement social des familles africaines ».
3. « La chance d’avoir des parents communistes » – Jean-Claude Michéa, invité sur France Culture le 7 janvier 2019. 4. Bien qu’en cet ouvrage, à travers quelques chroniques, j’évoque le thème en semant ses graines, un ouvrage paraîtra bientôt, dédié exclusivement à cette matière, avec toute la complexité et la minutie qui lui sied. Comme je l’ai exposé dans ma préface.
5. Quelques exemples : 1977: Plan « Habitat et Vie sociale » dans 53 banlieues – 1981: Instauration des ZEP – 1983: Plan « Espoir Banlieues » – 1996: Plan « Marshall » – 1999: Premier plan Jospin – 2000: Solidarité au Renouvellement urbain – 2001: Second Plan Jospin – 2003: Plan « Espoir Banlieues 2 » – 2005: Plan de Rénovation Urbaine – 2008: Plan « Espoir Banlieues 3 » – 2013: Plan « Ville et Cohésion Urbaine » – 2018: Plan « Action Cœur de Ville’’. On estime que plusieurs dizaines de milliards d’euros ont été engagés dans ces plans . À lire notamment sur le sujet : l’article intitulé « Retour sur 40 ans de ‘plans banlieue’ », paru dans le journal Sud Ouest le 23 mai 2018. L’article « Les différents plans banlieue » du journal La Croix, datant du 30 juillet 2013, est également recommandé. De plus, les travaux de Laurent Davezies sont pertinents pour approfondir cette thématique. PS : Il est impératif, néanmoins, de comprendre que parfois, lorsqu’on évoque une banlieue ou un quartier, on laisse entrevoir l’IPH (l’indice de pauvreté), cette mesure froide et mécanique qui tente de circonscrire la misère. Elle s’appuie sur les salaires perçus et les aides sociales accordées. Mais le calcul de la richesse ne saurait se limiter à cette vision étriquée. En effet, parallèlement à cette réalité officielle, d’autres existences s’inscrivent dans une logique d’économie clandestine, se muent en rentiers par le biais de biens immobiliers dans leur pays d’origine, et ainsi de suite. Naviguez au volant d’une Twingo dans ces quartiers, et vous vous exposerez ouvertement aux moqueries. Posséder un tel destrier est hautement déprécié, là où les jeunes, habiles tant dans les arcanes de la légalité que de l’illégalité, parviennent à s’offrir des véhicules jugés plus dignes. Celui qui n’affiche pas les marques est mal perçu, et la racaille, en vérité, réserve le terme « clochard » pour incarner l’ultime insulte, plus pernicieuse encore que le venimeux « fils de pute ». Être dépossédé de toute valeur matérielle et financière est un sacrilège aux yeux de ces âmes. Ornées des dernières technologies pour certains, vivant un train de vie tutoyant sieur Dubaï et dame Thaïlande, on est assez éloignés de Germinal, si je puis me permettre.
6. J’entends résonner au loin les voix bourdieusiennes, martelant leurs théories sur l’inégalité des conditionnements, et ainsi de suite. Assurément, l’observance de ces différences s’érige en fonction du décorum qui s’impose, ce jeu de représentation qui se déploie sous nos yeux. Il est évident que la mise en scène de l’action concernant la délinquance en Seine-Saint-Denis ne saurait être similaire à celle qui se joue dans les terres reculées du Cantal. Mais toujours est-il que ces pratiques s’ajustent selon les proportions, le décorum et l’atmosphère environnante.
Ézékiel Jaad,
le 27 Août 2023.
Tous droits réservés.